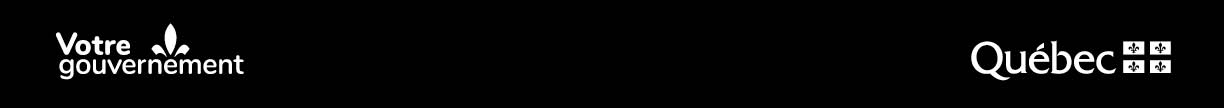Cinq bonnes raisons de désherber hâtivement. Virus de la jaunisse nanisante de l'orge : quelques cas confirmés en Montérégie et au Centre-du-Québec. Vers fil-de-fer : quand débuter le dépistage? Gestion du canola spontané. Carence en manganèse dans les céréales à paille : diagnostic et correction. Mouche des semis : mise à jour du pic dans certaines régions.
CINQ BONNES RAISONS DE DÉSHERBER HÂTIVEMENT VOS CHAMPS
B. Duval1, S. Mathieu1 et V. Samson1
1. Agronome (MAPAQ)
Les interventions de désherbage en début de saison, qu’elles soient réalisées avant ou peu après la levée de la culture, offrent plusieurs avantages. Voici cinq bonnes raisons de prioriser le désherbage en début de saison :
- Limiter la compétition dès le départ. Réduire la compétition des mauvaises herbes pendant la période critique (tableau 1). En éliminant les mauvaises herbes tôt, on limite leur concurrence avec la culture pour la lumière, l’eau, les nutriments et l’espace. Cela favorise une levée uniforme de la culture.
| Culture | Période critique d'absence de mauvaises herbes |
| Maïs | Stade 2 à 8 feuilles |
| Soya | Stade 1 à 3 feuilles trifoliées (V2 à V3) |
| Céréales de printemps | Stade 1 à 3 feuilles (stades 10 à 13 sur l'échelle de Zadoks) |
| Blé d'automne | 500 à 1 000 degrés-jours (température de base de 0 °C) (calculés à partir de la date de semis) |
| Cultures fourragères | Année d'établissement : 4 à 6 semaines après le semis |
| Canola | De la levée jusqu'au stade 6 feuilles |
| Haricots blancs | De la 2e feuille trifoliée jusqu'à la première floraison (V2 à R1) |
- Maximiser l’efficacité des interventions. Les mauvaises herbes sont beaucoup plus faciles à contrôler à un jeune stade (prélevée ou quelques feuilles) : les traitements herbicides sont plus efficaces et les outils mécaniques peuvent être utilisés de façon optimale avant que les racines ne s’implantent solidement.
- Réduire les risques pour la culture. En éliminant rapidement les mauvaises herbes, on limite leur rôle d'abri ou de pont pour les ravageurs (comme le ver gris-noir ou la légionnaire uniponctuée) et certains agents pathogènes susceptibles d'infecter la culture.
- Tirer profit des conditions printanières favorables. Les pluies de plus de 10 mm activent efficacement les herbicides de prélevée et augmentent leur performance. Intervenir tôt permet souvent de profiter de cette fenêtre naturelle.
- Réduire les coûts et prévenir la résistance. Un bon désherbage en début de saison peut diminuer le recours à des interventions de rattrapage plus coûteuses en postlevée. Il permet aussi de limiter l'usage répété d'herbicides d'un même groupe, ce qui aide à prévenir l'apparition de mauvaises herbes résistantes.
En somme, un désherbage hâtif réduit efficacement la concurrence, protège la culture contre plusieurs stress et favorise un meilleur démarrage. Résultat : des cultures plus vigoureuses et un rendement global optimisé.
Pour en apprendre davantage sur le sujet, consultez la fiche technique Désherbage de début de saison ainsi que les bulletins sur le désherbage mécanique en grandes cultures, produits par le CETAB+.
T. Copley1, J. Saguez1, V. Samson2, B. Duval2 et Y. Faucher2
1. Chercheur (CÉROM) 2. Agronome (MAPAQ)
Quelques cas de virus de la jaunisse nanisant de l’orge (VJNO ou « Barley yellow dwarf virus », BYDV en anglais) ont été confirmés dans quelques champs de blé d’automne en Montérégie-Est (MRC de Rouville, de la Vallée du Richelieu) et au Centre-du-Québec (MRC d’Arthabaska). Il est exceptionnel que les symptômes soient visibles aussi tôt en saison, ce qui indique que les infections ont eu lieu à l’automne 2024 en raison des températures chaudes qui ont permis une période prolongée pour la transmission du virus. Le dépistage de pucerons au cours de la saison est important pour évaluer le risque de transmission du virus dans les céréales de printemps. Aucun cas de puceron des céréales n’a été rapporté au RAP Grandes cultures en date du 14 mai 2025.
Les symptômes se présentent sous forme de foyers. Au début, les extrémités des feuilles supérieures présentent une décoloration allant du jaune au rouge, parfois même au mauve. Les feuilles infectées sont dressées. En cas d’infection hâtive, les plantes peuvent être rabougries (montre des signes de nanisme), ne pas monter en épi et ont souvent des racines peu développées. Les symptômes mettent généralement au moins deux semaines à apparaître après la transmission du virus. Des conditions chaudes et sèches favorisent le développement des symptômes et accentuent les pertes de rendement.
Au Canada, le virus est transmis par cinq espèces de pucerons, incluant Rhopalosiphum padi (puceron bicolore des céréales), Sitobion avenae (puceron des céréales) et Rhopalosiphum maidis (puceron du maïs). Il peut entraîner des pertes de rendement importantes lorsque la transmission du virus survient avant la montaison. Le virus ne se transmet ni par la semence, ni par le sol. Il peut infecter le blé, l’avoine, l’orge, et le maïs, ainsi que certaines mauvaises herbes graminées. L’avoine et l’orge sont considérées comme les cultures les plus susceptibles. Les ponts verts, soit les repousses de cultures et les graminées présentes en bordure ou dans les champs voisins, peuvent servir de réservoirs pour le virus, particulièrement en présence de fortes populations de pucerons. Pour les céréales d’automne, un automne chaud et sec aux États-Unis augmente le risque d’arrivée tardif de pucerons ailés par les vents, augmentant le risque de transmission du virus en fin de saison.
Aucun traitement n’existe pour le contrôle de ce virus et aucun seuil économique d’intervention basé sur l’abondance de pucerons n’a été validé au Québec pour cette maladie.
Moyens de prévention :
Aucune pratique agricole ne peut complètement protéger un champ du VJNO, mais certaines pratiques peuvent aider à réduire le niveau de risque de transmission du virus.
- En cas de forte infestation de pucerons dans une région, semer les céréales d’automne plus tard pour limiter la période d’exposition aux pucerons et la transmission du virus.
- Semer les céréales de printemps plus tôt en saison, afin de permettre aux plantes d’atteindre un stade plus avancé avant que les pucerons arrivent.
- Limiter les ponts verts (mauvaises herbes et repousses de céréales).
- Assurer une fertilisation adéquate du champ.
- Les ennemis naturels comme les coccinelles, les syrphes et les guêpes parasitoïdes peuvent aider à réduire les populations de pucerons.
À ne pas confondre :
Certaines carences peuvent créer des symptômes similaires, comme une carence en potassium, dont les symptômes débutent sur les feuilles à partir de la base des plantes. Les symptômes précoces de certaines maladies foliaires ou de stress abiotiques peuvent aussi être confondus avec le VJNO.
Pour plus d’information, consultez la fiche IRIIS Virus de la jaunisse nanisante de l’orge (BYDV) – avoine.
Si vous observez des cas du VJNO, le RAP Grandes cultures vous invite à le signaler en contactant votre responsable régional du MAPAQ.
J. Saguez1, S. Boquel1, B. Duval2, V. Samson2
1. Chercheur (CÉROM) 2. Agronome (MAPAQ)
Ce printemps, la météo est capricieuse et peut avoir retardé les travaux dans les champs (épandage de fumier, semis, etc.). Le RAP Grandes cultures reçoit plusieurs questions concernant le dépistage des vers fil-de-fer. Doit-on attendre que le semis ait eu lieu ou peut-on commencer le dépistage dès maintenant?
Rappelons qu’il faut attendre que le sol soit suffisamment réchauffé (c’est-à-dire qu’il ait atteint 12 °C) pour commencer le dépistage. Mesurez la température du sol ou vérifiez sur Agrométéo Québec pour savoir si c’est le cas. La température du sol peut être variable dans un même secteur. Elle est grandement affectée par la texture du sol, le couvert végétal présent ainsi que la température ambiante. En date du 16 mai 2025, dans certains secteurs, le sol n’avait pas encore atteint cette température.
Assurez-vous de coordonner votre dépistage avec l’entreprise agricole et ses travaux aux champs. Si la température du sol a dépassé 12 °C et que le semis est prévu dans une semaine ou plus, vous pouvez installer les pièges et les relever avant le semis. En revanche, si les semis sont prévus dans quelques jours, il est préférable d’attendre qu’ils soient réalisés pour éviter que les pièges soient détruits lors du passage de la machinerie.
GESTION DU CANOLA SPONTANÉ
B. Duval1, S. Flores-Meija2 et V. Samson1
1. Agronome (MAPAQ) 2. Chercheure (CÉROM)
CARENCE EN MANGANÈSE DANS LES CÉRÉALES À PAILLE : DIAGNOSTIC ET CORRECTION
1. Agronome (MAPAQ)
Des symptômes de carence en manganèse (Mn) sont présentement observés dans certains champs de céréales d'automne. Cette carence apparaît le plus souvent dans un sol ayant un pH élevé et une faible teneur en Mn disponible.
Les symptômes apparaissent généralement lorsque les plants sont encore au stade végétatif, en mai pour les céréales d'automne et en juin pour les céréales de printemps. On reconnait la carence principalement par une chlorose entre les nervures (les nervures des feuilles sont vertes alors que le reste du limbe est jauni) se manifestant d’abord sur les jeunes feuilles. Les plants atteints ont également un port affaissé.
Les pulvérisations foliaires de Mn sous forme de sulfate de manganèse (MnSO4) sont efficaces pour corriger les carences en cet élément chez les céréales à paille. La période optimale pour effectuer le traitement se situe à la fin du tallage. Si une carence sévère est décelée tardivement, une application plus tardive que le stade recommandé de la culture pourrait être envisagée, même si cela n’est pas idéal, car le rendement est déjà affecté et la réponse sera généralement moins marquée.
Ne confondez pas la carence en Mn avec certaines maladies ou d’autres problèmes phytosanitaires. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique La carence en manganèse dans les céréales à paille et le soya.
MISE À JOUR DES DATES DU PIC D'ACTIVITÉ DES ADULTES DE LA MOUCHE DES SEMIS, UN RAVAGEUR POTENTIEL
S. Boquel1, V. Samson2, B. Duval2, M. St-Laurent2
1. Chercheur (CÉROM) 2. Agronome (MAPAQ)
Une mise à jour des résultats du modèle prévisionnel du pic d’émergence des adultes de la mouche des semis, basé sur l’accumulation de degrés-jours, a été réalisée le 14 mai 2025 (voir les prévisions dans le tableau ci-dessous). Pour rappel, selon les normales de saison au Québec, le pic d’activité de la mouche arrive habituellement vers la fin de la période des semis, et peu de champs sont endommagés. Toutefois, comme la période des semis s’étire dans plusieurs régions, la situation pourrait être différente cette année.
Le pic sera bientôt atteint dans les régions de la Montérégie Est (16 mai) et Ouest (17 mai), suivi de l’Estrie (20-24 mai), Lanaudière (21-24 mai) et le Centre-du-Québec (22-26 mai). Pour les autres secteurs, ce sera plus tard en mai ou début juin. Les champs semés à une date proche du pic d’activité et présentant des facteurs de risque pourraient subir des dommages de mouche des semis. Ces champs seront à surveiller au moment de la levée de la culture.
Pour en savoir plus sur les facteurs de risque et sur les méthodes de prévention, consultez l’avertissement N° 3 du 9 mai 2025 et la fiche technique Mouche des semis.
| Prévisions en date du 14 mai 2025 | ||
| Région | Date prévue du pic d'émergence des adultes de mouches des semis (50 %) | Mouches des semis adultes émergées (%) |
| Abitibi-Témiscamingue | 6 juin | 8,1 |
| Bas-Saint-Laurent | 9 - 13 juin | 5,5 - 6,4 |
| Capitale-Nationale | 3 - 8 juin | 7,4 - 9,9 |
| Centre-du-Québec | 22 - 26 mai | 19,9 - 30,6 |
| Chaudière-Appalaches | 2 - 7 juin | 8,1 - 11,4 |
| Estrie | 20 - 24 mai | 27,1 - 35,9 |
| Lanaudière | 21 - 24 mai | 24,4 - 30,8 |
| Laurentides | 22 mai | 26,6 |
| Mauricie | 1 juin | 11,3 |
| Montérégie-Est | 16 mai | 45,6 |
| Montérégie-Ouest | 17 mai | 41,4 - 41,9 |
| Outaouais | 25 - 28 mai | 17,7 - 21,9 |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | 8 juin | 6,5 |
| Toute intervention envers un ennemi des cultures doit être précédée d’un dépistage et de l’analyse des différentes stratégies d’intervention applicables (prévention et bonnes pratiques, lutte biologique, physique et chimique). Le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) préconise la gestion intégrée des ennemis des cultures et la réduction des pesticides et de leurs risques. |
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le secrétariat du RAP. Édition : Marianne St-Laurent, agr., M. Sc. et Lise Bélanger (MAPAQ). La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite.